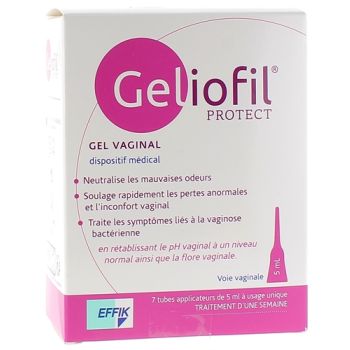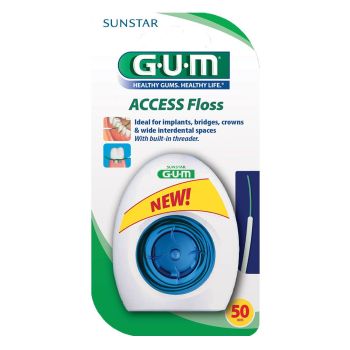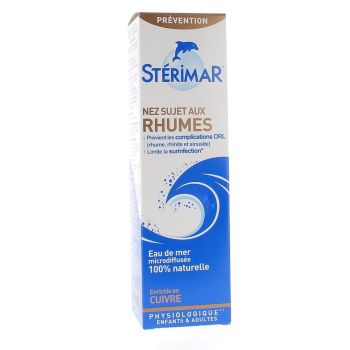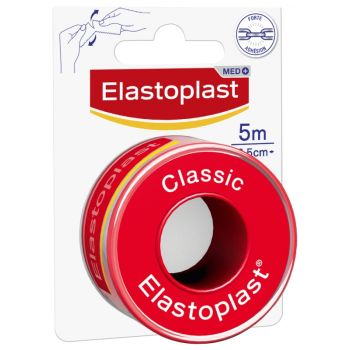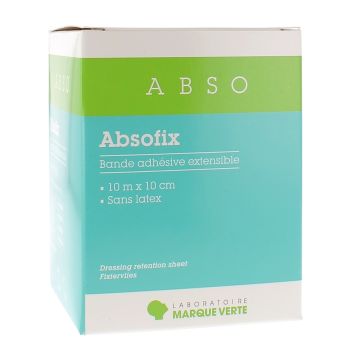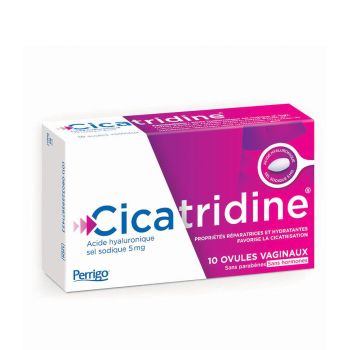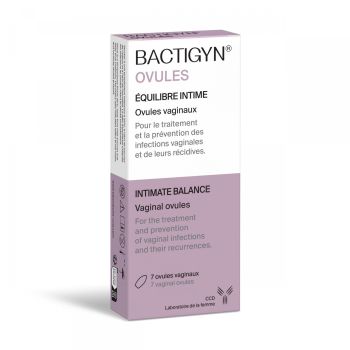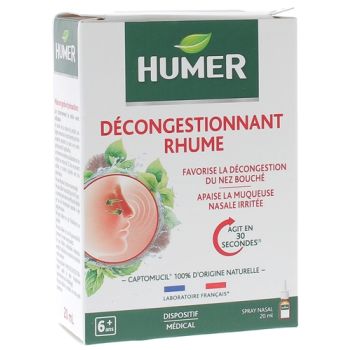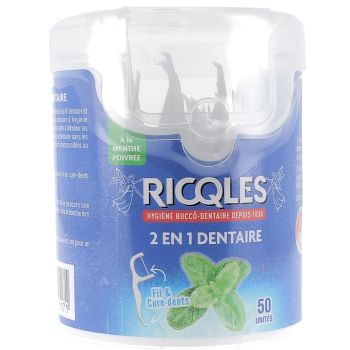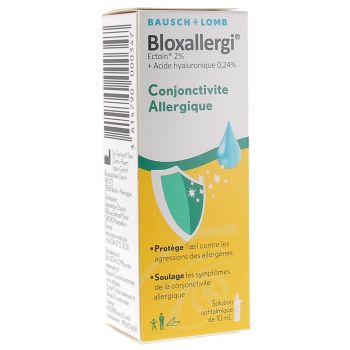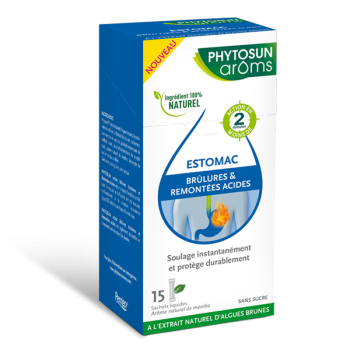Qui peut prescrire un dispositif médical ?
Les dispositifs médicaux sont soumis à une prescription médicale. À part les médecins, d’autres professionnels de santé peuvent également prescrire des dispositifs médicaux notamment les infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes et les sages-femmes. D’autres professionnels sont aussi habilités à prescrire un dispositif médical, il s’agit entre autres des pédicures-podologues, des orthoptistes et des orthophonistes.
Pour ce qui est des aides techniques, l’on peut en outre les qualifier de dispositifs médicaux. Seulement, la prescription doit être élaborée en fonction du type de besoins auxquels elle sera destinée. Ceci afin de favoriser la conformité du produit avec son utilisation.
Les fauteuils roulants électriques sont également considérés comme des dispositifs médicaux à part entière. En effet, ils appartiennent à la classe I, celle qui représente un faible risque. Il peut notamment s’agir des matériels de maintien à domicile et d’aide à la vie pour malades et handicapés. Ce genre de matériel est surtout utilisé pour compenser certaines fonctions altérées par des maladies neuromusculaires. Le soulève personne, les coussins de positionnements, le lit médicalisé en sont des exemples. Sans oublier le matelas, le surmatelas d’aide à la prévention des escarres, les attelles, etc.
Dispositif médical : qui sont les acteurs du secteur ?
Concernant le dispositif médical, la législation européenne a identifié les acteurs principaux. Notamment le fabricant, l’organisme notifié, l’autorité compétente et l’utilisateur. Ce dernier peut désigner les professionnels de santé, les patients ainsi que les tiers. Le fabricant désigne la personne physique ou morale qui se charge de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l’étiquetage d’un dispositif médical afin de le mettre sur le marché.
L’organisme notifié est un organisme tiers chargé d’évaluer si le dispositif médical satisfait aux exigences de mise sur le marché. Ces dernières ont été prescrites par la directive du dispositif médical. Les organismes notifiés doivent répondre aux critères d’indépendance, d’intégrité, d’impartialité, de formation et de compétence. Par conséquent, un organisme notifié peut être spécialisé dans certaines activités et classes de dispositifs médicaux. Un organisme notifié aura pour rôle d’évaluer les dossiers fournis par le fabricant, de réaliser des audits des fabricants, etc. En France, cet organisme notifié est le Laboratoire national de métrologie et d’essais/Groupement pour l’évaluation des dispositifs médicaux (LNE/G-MED).
L’autorité compétente se charge de la surveillance du marché national des dispositifs médicaux. L’autorité compétente en France est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ce dernier intervient aussi dans le processus de désignation et de contrôle de l’organisme notifié français.
La mise sur le marché d’un dispositif médical
Pour mettre un dispositif médical sur le marché, le fabricant doit suivre le règlement européen. Après avoir démontré la conformité de leur produit, le marquage CE sera alors apposé sur celui-ci. Cette opération doit se faire avant la commercialisation du dispositif médical. L’estampillage CE signifie que le dispositif médical répond aux exigences essentielles de l’UE en matière de performance et de sécurité.
Ces exigences fixent les objectifs afin que l’emploi du dispositif médical ne porte pas préjudice à l’état clinique des patients. Elle ne doit pas porter atteinte à la sécurité et à la santé des utilisateurs et leur entourage. La mise sur le marché de tout dispositif médical, autre que la classe I, est soumise à l’obtention d’un certificat CE. Ce certificat est délivré par un organisme notifié habilité par les autorités compétentes.
En métropole, l’autorité compétente est l’ANSM et le seul organisme notifié est le GMED. C’est donc le GMED qui entre en action afin d’évaluer la conformité de la procédure suivie par le fabricant. C’est en fonction de la classe du dispositif que l’évaluation du dispositif médicale s’effectue. Ainsi, il peut être réalisé par le biais d’examens du dossier de conception du dispositif médical fourni par le constructeur.
Il peut aussi être exécuté par le biais d’essais sur le produit. Cette évaluation peut porter sur le système de production mis en place par le fabricant au moyen d’un audit sur site. Cette procédure permet de s’assurer que le dispositif médical est conforme aux normes techniques.
Ces dernières pouvant être en rapport avec la sécurité électrique, stérilisée, compatibilité biologique. Elles peuvent également intégrer l’évaluation de données cliniques. Le dispositif médical se doit d’atteindre les performances assignées par le fabricant. De plus, l’utilisation du produit ne doit pas exposé le patient à des risques potentiels.
Le dispositif médical sera placé sous la responsabilité du constructeur après sa mise sur le marché. C’est donc à lui d’assurer sa surveillance. À noter que les fabricants font périodiquement l’objet d’audits. En effet, le marquage CE exige cette procédure. C’est l’ANSM qui prend en charge la surveillance et le contrôle du marché. Il peut être amené à prendre des mesures sur les DM pouvant aller jusqu’à leur retrait du marché.
Les responsabilités et obligations des utilisateurs d’un dispositif médical
Au moment de l’achat d’un dispositif médical, l’utilisateur doit s’assurer de la conformité de celui-ci à la réglementation. Il doit vérifier notamment la présence du marquage CE, la notice d’instruction, l’étiquetage, etc. Il doit également s’assurer de la pérennité de la conformité du dispositif durant sa durée de vie. Veiller particulièrement à la condition de stockage, d’entretien, etc.
Il doit aussi garantir la sécurité de l’utilisateur du dispositif médical. Notamment en fournissant des formations, des informations, de façon adéquate et régulière. On doit également s’assurer de la sécurité des patients sur lesquels le dispositif médical doit être utilisé. Ce point concerne l’hygiène, la stérilité, condition d’utilisation, etc.
Précaution de stockage et d’utilisation des dispositifs médicaux
Des précautions sont à prendre en compte quant aux stockages et à l’utilisation de ce genre de produit. Ainsi, chaque emballage des dispositifs médicaux stériles ne doit pas être plié. Prenez également soin de bien vérifier le respect de l’intégrité de l’emballage des dispositifs médicaux stériles avant leur utilisation.
L’usager ne doit en aucun cas se servir d’un dispositif médical stérile si l’emballage est mouillé ou froissé. La date de péremption doit être vérifiée de façon régulière. Avant utilisation, prenez soin de bien lire l’étiquetage ainsi que la notice d’instruction.
En cas de doute concernant son emploi ou sa réutilisation, il est conseillé de s’adresser directement au fabricant en demandant une réponse écrite. Les indications erronées, omises dans l’étiquetage ou la notice d’instruction est susceptible de faire l’objet d’une déclaration de matériovigilance.
Qu’est-ce que la matériovigilance ?
La matériovigilance a comme objectif de surveiller les incidents ou les risques d’incident. Ces derniers peuvent résulter de l’utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. Il existe deux types de signalements à savoir le signalement obligatoire et le signalement facultatif.
Les signalements obligatoires se font sans délai. Notamment, si un dispositif médical est impliqué dans un incident ou risque d’incident pouvant entraîner ou susceptible d’entraîner la mort. Ou si celui-ci cause une dégradation grave de l’état de santé d’un utilisateur ou d’un tiers.
Les signalements facultatifs se font dans les cas où : un incident non voulu se produit lors de l’utilisation d’un dispositif médical conforme à sa destination. Cela pourrait concerner une réaction préjudiciable et non voulue constatée l’utilisation d’un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant. Il peut également s’agir de dysfonctionnement ou d’altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif médical. Pareil pour les indications erronées, l’omission ou l’insuffisance d’information dans la notice d’instruction, le mode d’emploi ou le manuel de maintenance.
Qui doit déclarer la matériovigilance ?
Ce sont les personnes qui ont pris connaissance d’un incident ou d’un risque d’incident qui doit déclarer la matériovigilance. Il peut s’agir d’un professionnel de santé incluant le pharmacien d’officine, les fabricants et les tiers. Ces derniers peuvent être un intermédiaire auprès des distributeurs. La déclaration se fait à l’aide du portail national spécialement dédié aux événements sanitaires. Le signalement peut également se faire sur le site de l’ANSM.
Dans la pratique, avant de faire votre déclaration, vous devez vous poser la question s’il s’agit bien d’un dispositif médical. Ensuite, vous devez savoir si son utilisation a été faite dans les conditions normales. Vous pouvez aussi vous interroger sur l’éventuelle cause. Notamment, si c’est le dispositif lui-même, ses performances ou la notice d’emploi. Est-ce que le défaut aurait pu être détecté avant son utilisation ? Est-ce que la nature des conséquences cliniques est grave ou non ? Vous devez également vous demander si l’incident doit être signalé de façon obligatoire ou facultative. Est-ce qu’il faut engager les mesures de conservation à savoir le retrait de lot, informer les patients, etc. ?
À noter qu’un professionnel de santé s’abstenant de signaler sans délai un incident peut être sanctionné. En effet, il risque 4 ans d’emprisonnement et 76 224 d’euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Si vous avez des doutes pour savoir si oui ou non vous devez faire une déclaration de matériovigilance, vous pouvez contacter le correspondant local de matériovigilance d’un centre hospitalier.
La prise en charge d’un dispositif médical par l’assurance-maladie
Les dispositifs médicaux sont pris en charge par l’assurance-maladie. Cette procédure s’effectue suivant différents tarifs et démarches. Pour savoir quels sont les produits et prestations prises en charge par l’assurance-maladie, vous pouvez consulter la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). C’est également cette dernière qui définit le taux de remboursement. À noter que quelques prestations qui permettent d’adapter le dispositif au patient peuvent aussi être prises en charge. Les restes à payer après perception de l’assurance-maladie peuvent être pris en charge par les mutuelles santé.
L’évolution de la réglementation d’un dispositif médical
Une révision complète de la réglementation européenne concernant les dispositifs médicaux a été effectuée. Celle-ci a pour objectif de renforcer la sécurité sanitaire et harmoniser les règles qui s’appliquent aux dispositifs médicaux. Cette révision simplifie et améliore leur lisibilité et permet de mieux s’adapter à l’innovation.
La révision porte sur deux nouveaux règlements concernant les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ces modifications apportent plus de transparence et de facilité de mise en place d’une gouvernance européenne relative aux dispositifs médicaux. Elles portent également sur l’amélioration de l’évaluation pré et post mis sur le marché du dispositif.
Par conséquent, le secteur des dispositifs médicaux est soumis à de nouvelles exigences. En voici quelques exemples : il y aura une personne qui veille au respect de la réglementation des fabricants et des mandataires. En outre, les importateurs et les distributeurs sont soumis à des obligations de prudence. L’autorité désignée doit avoir la capacité d’inspecter les opérateurs de l’industrie.
Afin d’améliorer l’harmonisation des pratiques, les organismes notifiés suivront un cahier des charges qui sera renforcé en termes de compétence et de contrôle. Ceci se traduira par des visites inopinées chez les fabricants. De plus, ces derniers seront placés sous contrôle européen.
La mise en place de nouvelles procédures de consultation pour la certification CE. a été faite dans le but de garantir l’évaluation avant la mise sur le marché. L’évaluation clinique par des investigations cliniques deviendra essentielle pour les dispositifs implantables. De plus, l’organisation notifiée sera obligée d’effectuer une consultation de groupe d’experts européens concernant les dossiers cliniques des nouveaux dispositifs médicaux implantables de classe III. En ce qui concerne les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de classe D, la consultation d’un laboratoire de référence européen est obligatoire.
Pour renforcer le dispositif de vigilance des dispositifs médicaux, la notification des incidents au niveau européen a été mise en place. De plus, les fabricants seront désormais appelés à produire périodiquement des rapports de sécurité